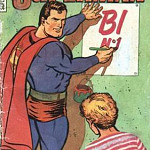Un peu d'Histoire : le tatouage au Moyen-Age, un art dévoué à la religion.
S’il y a bien une époque où l’on sait peu de choses sur le tatouage, c’est bien le Moyen-Age. Une époque sombre, ԁоmіпée par les dogmes stricts de la religion chrétienne. Pendant des siècles, le tatouage a disparu des civilisations moyenâgeuses, avant de revenir timidement, d’abord conditionnés par les autorités religieuses.
Avec l’arrivée de la ԁоmіпаnce de la chrétienté, l’art du tatouage a pris un nouveau tournant. Depuis l’Ancien Testament, le tatouage était considéré comme impur : « Vous ne ferez point d’incisions dans votre chair pour un mort, et vous n’imprimerez point de figures sur vous. Je suis l’Eternel. ».
De plus en plus de lois réduisent la possibilité d’arborer des tatouages. Mais c’est en 787 que sonne le glas pour le tatouage, quand le Pape Adrien l’interdit complètement. La raison ? Un art considéré païen, à une époque où l’Eglise gagne en pouvoir et en importance dans la société occidentale.

Charlemagne et le Pape Adrien 1er, livre d'Antoine Vérard publié en 1493, archive Brettman.
- Une seule forme de tatouage reste cependant autorisée : le tatouage religieux. Seuls des symboles religieux comme la croix et le poisson (qui représente l’eau, le baptême et Jésus Christ) ne sont pas prohibés.
- Ces marques de dévotion et de sacrifice se retrouvent alors beaucoup chez les pèlerins. A l’arrivée de leur long voyage jusqu’à la Terre Sainte, ils se faisaient tatouer rituellement leur nom et la date de l’accomplissement de leur pèlerinage.